Le langage révèle l’époque. Notre chroniqueuse s’interroge ce mois-ci sur l’usage des termes «kichta», «liberticide» et «QR code».
Kichta
Après le fric, le pognon, le flouze, le pèze, l’oseille ou, plus récemment, la moula, le lexique de l’argent s’enrichit grâce au rap. Place depuis peu, à la «kichta» qui désigne une liasse de billets de banque. Ce mot, très présent actuellement dans les textes des rappeurs, vient de l’argot des dealers. Son étymologie n’est pas clairement déterminée.
Grace au succès de leur musique, le vocabulaire des rappeurs est très rapidement repris par des milliers de fans qui les popularisent. «Les rappeurs sont très présents sur Snapchat, relève Fred Musa, animateur de Planète Rap sur la radio Skyrock. Ça a l’effet d’une caisse de résonance. C’est aussi pour cela que certains mots se démodent rapidement. Chaque génération a sa bande-son.»
La kichta connaîtra-t-elle le succès de la moula que tous les jeunes –et des bien moins jeunes–, connaissent? Un premier pas a en tous cas été franchi avec son entrée dans le «Dictionnaire de la Zone», en attendant de débarquer un jour dans le Larousse.
Liberticide
L’usage de l’adjectif liberticide, –autrement dit qui détruit la liberté–, abonde en ce moment. Partout, des atteintes à la liberté sont dénoncées. On retrouve le terme dans le contexte de la lutte contre le Covid-19 et ses contraintes sanitaires, mais aussi de Kaboul à Porrentruy, avec la prise du pouvoir par les Talibans ou l’interdiction du crop top dans un collège, en passant par les manifestations dans les démocraties de plus en plus nombreuses à être menacées de dictature.
De quelle définition de la liberté parle-t-on? De quoi se réclament les uns et les autres? Le mot «liberté» est comme un synonyme de «faire ce que je veux» pour les égoïstes. Pour les oublieux, il signifie la liberté d’exercer des droits et non des devoirs. La «liberté» qui trouve aussi ses limites dans la liberté de l’autre pour les tenants de la démocratie qui articulent liberté publique et liberté individuelle. «Liberté», aussi, d’agir conformément à leur responsabilité de protéger le plus grand nombre, pour les politiciens, ou encore la liberté de se comporter en «abruti», pour les «abrutis», selon Arnold Schwarzenegger.
L’usage du terme donne au moins l’occasion de s’interroger sur notre propre définition et usage de la liberté.
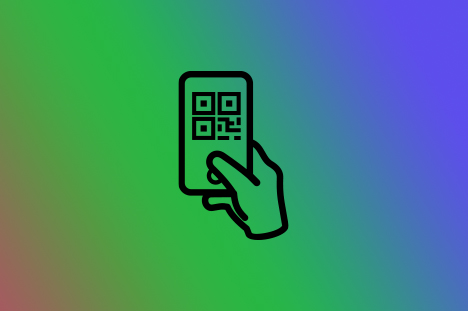
QR code
Tendre son QR code devient un geste banal de notre quotidien. La liste des lieux interdits sans cette clé d’accès s’allonge. Or, la familiarité de cette technologie ne va pas de pair avec la connaissance que nous en avons. Nombreux sont ceux qui ignorent ce que signifient ces deux lettres «Q» et «R» et quelle est leur histoire.
Le QR Code signifie «Quick Response Code» en anglais, «code à réponse rapide» en français. Créé par au Japon par Masahiro Hara en 1994, il permettait de suivre l’itinéraire des pièces détachées automobiles dans les usines Toyota. L’ingénieur s’est inspiré du design du jeu de go pour concevoir ces carrés tachetés de noirs sur fond blanc. Contrairement au code barre qui est unidimensionnel, le QR code est bidimensionnel, et donc apte à stocker davantage d’informations. Son usage s’est démocratisé avec l’arrivée des smartphones équipés d’un appareil photo capable de le scanner.
Après avoir été essentiellement ludique, au service du tourisme, du contrôle des billets de transport et des réservations, le QR code se dote depuis peu d’un usage sanitaire bien imprévu.


