Plus d’un siècle un demi après son apparition, le mot fait toujours peur aux entreprises qui en redoutent les effets économiques, mais aussi symboliques. Quelles sont les nouvelles formes du boycott et qui attaque-t-il? Est-ce toujours une méthode efficace?
Une version de cet article réalisé par Large Network est parue dans PME Magazine.
_______
«Ici, on tue des Ouïghour-e-s.» L’avertissement a été placardé sur les vitrines de nombreuses enseignes à Paris. La raison: suite aux révélations sur les exactions commises par la Chine auprès des Ouïghours, des voix se sont élevées pour inciter les consommateurs à boycotter des marques accusées de bénéficier du travail forcé de ces populations musulmanes. Apple, Zara, Mercedes, BMW… Plus de 80 multinationales se sont retrouvées pointées du doigt par une organisation australienne, l’Australian Strategic Policy Institute, dans un appel relayé notamment par le député européen Raphaël Glucksmann. Depuis, le groupe Lacoste s’est engagé à cesser toute activité avec ses fournisseurs chinois concernés. D’autres, comme Calvin Klein ou Tommy Hilfiger, ont annoncé leur intention de stopper toute relation avant même le début de la campagne publique.
«Le boycott est l’arme des minorités et des opprimés, la tribune des sans-voix», expliquent les chercheuses Ingrid Nyström et Patricia Vendramin dans leur livre «Le Boycott». Mais qu’est-ce qu’un boycott? «Le terme englobe des usages, des buts et des cibles assez différents mais repose toujours sur le refus d’entrer dans une relation d’échange qui peut être commerciale, politique, culturelle, sportive, diplomatique, explique Philippe Balsiger, professeur à l’université de Neuchâtel et spécialiste des processus de contestation des marchés, qui rappelle que ce mode d’action militant est surtout utilisé dans l’arène marchande. Que la cible soit une entreprise ou une institution, c’est un moyen de pression, une sanction qui relève de la mise en quarantaine.»
Frapper au portefeuille
Le terme n’apparaît qu’à la fin du 19e siècle (voir l’encadré), mais le boycott a été pratiqué sur tous les continents par des populations qui en ont fait au fil des décennies un de leurs moyens de pression privilégiés contre des marques et des entreprises, en réaction à des pratiques qui les heurtent ou pour obtenir un changement de stratégie commerciale ou tarifaire. «Les gens sont de plus en plus conscients que la manière dont ils dépensent leur argent a un impact», résume Jasmine Lorenzini, docteure en science politique à l’Université de Genève (UNIGE). D’autant que l’effort peut être payant, comme en témoigne la «grève du beurre» de mai 1967. «Lorsque le Conseil fédéral a décidé d’augmenter le prix du lait de trois centimes par litre, la Fédération romande des consommatrices a appelé au boycott et le Conseil et revenu sur sa décision», raconte la spécialiste.
Cibles privilégiées, les multinationales font régulièrement face à ce type de mouvements, à l’instar de Nestlé. A la fin des années 1970, l’entreprise a été confrontée à un boycott de plus de 20 ans, accusée par certains consommateurs de compromettre la santé des nourrissons dans les pays pauvres avec leurs substituts de lait maternel. La compagnie romande en a tiré les leçons: en 2010, elle a immédiatement réagi à la campagne lancée par Greenpeace qui dénonçait l’impact de la culture de l’huile de palme en Indonésie -utilisée notamment dans les Kit-Kat-, sur la disparition des orangs-outangs. Nestlé a alors rapidement rompu ses contrats avec la société Smart, premier producteur indonésien d’huile de palme, et s’est engagée à n’utiliser que de l’huile issue de l’agriculture responsable.
Mais les PME auraient tort de se croire moins exposées. En janvier 2020, des internautes ont milité pour un boycott du Slip Français, spécialisé dans les sous-vêtements. Connue pour sa communication décalée, l’entreprise a dû faire face à la colère de ses clients après la publication par trois de ses salariés de vidéos à caractère raciste sur Instagram. L’an dernier encore, un couple de gérants français a vu son supermarché déserté par une partie de la population locale, suite à la publication sur les réseaux sociaux de clichés du couple posant fièrement devant les dépouilles de lions, d’hippopotames et d’alligators tués au cours d’un safari.
La politique n’est jamais très loin
Le boycott attaque les entreprises mais porte aussi des enjeux politiques. Nouvelle-Angleterre, 1768: outrés par les taxes imposées par la Couronne anglaise, treize colonies d’Amérique du nord refusent d’acheter les cargaisons de thé de la Compagnie anglaise des Indes orientales. La crise culminera en 1773 avec la célèbre Boston Tea Party, point de départ de la lutte des futurs Etats-Unis pour leur indépendance. Inde, 1920: en pleine lutte pour l’indépendance, Gandhi invite les Indiens à délaisser les textiles britanniques et à tisser eux-mêmes leurs vêtements. Alabama, 1955: après l’arrestation de Rosa Parks, Martin Luther King prend la tête d’un mouvement et invite l’ensemble de la communauté afro-américaine de la ville à ne plus emprunter les transports urbains. Après 381 jours d’un boycott ininterrompu, la Cour suprême tranche en faveur des militants des droits civiques, jugeant illégale la ségrégation dans les bus. Ces exemples sont emblématiques. Pour le professeur Philippe Balsiger, «les boycotts les plus visibles sont lancés par des organisations ou des mouvements structurés, dotés de moyens appropriés».
Le récent appel du président turc Recep Erdoğan au boycott des produits français, suite à la défense réaffirmée par Emmanuel Macron du droit de la presse à publier des caricatures de Mahomet, en est un nouvel exemple. En 2012 déjà, plusieurs officiels trucs avaient appelé à des actions équivalentes après la reconnaissance par la France du génocide arménien. «L’exemple turc montre une forme de normalisation du boycott, remarque Jasmine Lorenzini de l’UNIGE. Il est tellement entré dans les répertoires d’action que tout le monde l’utilise, y compris les chefs d’Etat.» Mais plus ou moins ouvertement : formellement lancé par 171 ONG palestiniennes pour protester contre la construction d’un mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie, la campagne BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) est financée par des partis politiques depuis quinze ans.
Certains boycotts relèvent de la guerre d’influence, du soft power ou de la pression géopolitique, à l’instar des Jeux Olympiques. En 1980, pour protester contre l’invasion soviétique en Afghanistan, Jimmy Carter refuse la participation des États-Unis d’Amérique aux Jeux de Moscou, suivi de plus de soixante pays du bloc de l’Ouest. Quatre ans plus tard, l’URSS et une quinzaine de pays communistes renoncent à leur tour à participer aux JO de Los Angeles. Les JO sont moins ciblés depuis les années 2000, mais les grandes compétitions internationales restent des vitrines privilégiées, comme le Qatar peut le constater. Suite à l’enquête du journal anglais «The Guardian» qui révélait en février dernier que plus de 6’500 ouvriers immigrés seraient morts sur les chantiers du Mondial 2022, plusieurs clubs norvégiens ont demandé à ce que l’équipe nationale boycotte le tournoi. Idem chez leur voisin danois. Ainsi en 2019 déjà, face aux contestations, le FC Copenhague avait dû renoncer à plusieurs stages au Qatar et à Dubaï.
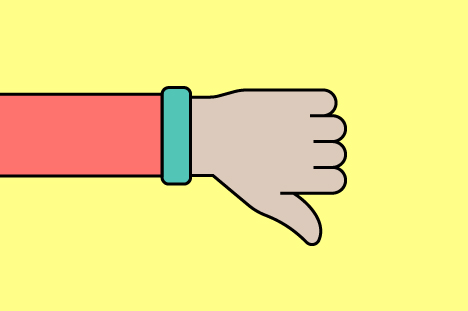
Effet de loupe
Le sport est une vitrine privilégiée des opérations de boycott parce qu’il cumule plusieurs atouts, explique Jasmine Lorenzini: «Il est visible, médiatisé et hautement symbolique.» De quoi obtenir un effet de loupe pour des militants conscients que leur impact purement économique est le plus souvent limité, renchérit Philippe Balsiger. «En règle générale, les appels au boycott ont peu de conséquences réelles sur entreprises ou les institutions visées parce qu’ils ne sont pas suivis assez massivement, développe le professeur. En revanche, ils peuvent avoir des effets indirects sur des organisations très attentives à leur image de marque.»
Surtout si on réussit à pointer ses paradoxes. «A la fin des années 1970, un activiste américain a voulu profiter de son offre de customisation pour inscrire le mot ‘esclavagiste’ sur sa paire de Nike, pour dénoncer les dérives de la politique de sous-traitance de l’entreprise et notamment le travail des enfants, développe Jasmine Lorenzini. L’entreprise a refusé mais le jeune homme a fait circuler ses réponses.» De quoi sérieusement érafler l’image de Nike, confronté à un mouvement qui détourne rapidement ses propres slogans, comme avec le «Boycott Nike? Just do it!». Preuve que les entreprises ne proposent pas que des produits mais aussi du sens et des symboles, que chacun peut s’approprier ou combattre: après avoir choisi comme égérie le footballeur Colin Kaepernick, opposant notoire à Donald Trump, de nombreux partisans de l’ex-président ont appelé à abandonner la marque en 2018 et ont posté des vidéos d’eux brûlant leurs paires de chaussures, avec le hashtag #boycottNike.
Un impact limité?
Le boycott serait-il l’arme absolue? Pas toujours. En 2003, une étude menée par l‘Université de Stanford University a ainsi montré que le boycott des vins français, lancé suite au refus du pays d’intervenir aux côtés de Georges Bush en Irak, aurait eu un impact négatif de 13% sur les ventes pendant un mois seulement. Même chose pour Netflix ou Disney+, deux plateformes de streaming confrontées à de récents appels au boycott. Le premier est accusé de défendre la pédophilie au travers du film «Mignonnes». Le second affronte deux mouvements distincts: d’un côté le camp progressiste accuse le géant américain de s’être arrangé des atteintes chinoises aux droits de l’homme pour tourner «Mulan», de l’autre les conservateurs reprochent à la firme californienne de céder aux sirènes de la cancel culture (voir l’encadré) en introduisant des panneaux d’avertissement sur les clichés racistes portés par certains de ses anciens longs-métrages comme «Les Aristochats». Mais ces attaques n’ont eu aucunes conséquences sur les deux plateformes en pleine expansion.
Ces exemples illustrent une forme d’évolution du boycott, facilité et comme banalisé par les réseaux sociaux. «Sur Twitter ou sur Facebook, appeler à boycotter est à la portée de tout un chacun», observe Philippe Balsiger. Néanmoins cela ne prête pas nécessairement à conséquence, le «bad buzz» ayant ses limites. En septembre dernier, le hashtag #CancelNetflix avait été retweeté plus de 200’000 fois en une seule journée. Ce qui n’a pas empêché la plateforme de réaliser 542 millions de dollars de bénéfices pour le seul quatrième trimestre de 2020, tout en franchissant la barre des 200 millions d’abonnés. Réseaux sociaux ou non, les fondamentaux du boycott ne changent pas, conclut le sociologue: «Pour obtenir des résultats, encore faut-il que ceux qui les lancent acteurs aient les moyens de s’organiser et de peser. Sans cela, cela revient à crier dans le désert.»
__________
Charles Boycott, la première cible
Macadam, poubelle, browning, velux … Autant de noms propres devenu noms communs, ce qui s’appelle en linguistique une antonomase. C’est le cas du capitaine Charles C. Boycott, intendant d’un propriétaire foncier qui décida en 1880 d’augmenter les loyers des terres qu’il gérait dans une des régions les plus pauvres d’Irlande. Pour une partie des fermiers concernés, la pression financière devint rapidement insupportable: incapables de payer, certains furent exilés et promis à une vie de misère.
Les cultivateurs imaginèrent alors une tactique non-violente et peu coûteuse: ignorer le capitaine Boycott et les paysans qui veulent racheter leurs terres. «Ils rompent toutes relations commerciales, de service, de courtoisie ou d’entraide avec eux, dans le but de les isoler complètement», expliquent Ingrid Nyström et Patricia Vendramin dans leur ouvrage «Le Boycott» (2015). Mis à l’index, ostracisé, Charles Boycott assiste impuissant au départ de ses domestiques, de ses ouvriers et de tout son personnel. En ville, les commerces refusent de le servir. À chaque déplacement, les marques de mépris ou d’indifférence se multiplient. Quelques mois plus tard, il se résout à quitter la région, laissant son nom à un mode d’action dont il aura été la première victime.
_______
Le «buycott», miroir inversé
Le «buycott» remplace une logique de sanction par une forme de prime ou de récompense aux entreprises dont les consommateurs jugent les pratiques cohérentes avec leurs propres valeurs. Basé sur le mot anglais «buy» (acheter), cette forme d’action engagée consiste à privilégier les marques, les produits ou les services qui défendent un modèle économique plus juste, plus vertueux ou plus équitable. Né dans les années 1960 avec l’émergence des préoccupations environnementales, le néologisme réapparait aujourd’hui avec la montée en puissance des mouvements militant pour une intensification de la lutte contre les dérèglements climatiques, en privilégiant par exemple une alimentation produite localement.
_______
La cancel culture, nouvelle forme de boycott?
«Culture du bannissement» ou de l’oubli, la cancel culture désigne une série d’initiatives militantes qui ont comme point commun la dénonciation d’un individu souvent public –auteur, artiste, responsable politique, célébrité–, accusé d’avoir agi ou parlé d’une manière discutable ou controversée. De l’auteure J.K. Rowling attaquée pour des propos transphobes, au film «Autant en emporte le vent» jugé raciste ou encore un personnage des Looney Tunes annulé pour son comportement de harceleur sexuel, ce rejet se fait aujourd’hui principalement par les réseaux sociaux.
Souvent rapprochée du boycott, dont elle peut reprendre le principe, la cancel culture évoque plutôt deux pratiques antiques: l’ostracisme grec, destiné à écarter un membre de la cité de ses cercles sociaux, et la damnation de la mémoire, pratique romaine destinée à effacer des archives et de l’espace public le nom et la vie d’un individu. Avec une nuance de taille: les deux décisions étaient respectivement votées par les assemblées des cités et par le Sénat romain, et non selon les opinions populaires.


