Le langage révèle l’époque. Notre chroniqueuse s’interroge ce mois-ci sur l’usage des termes «Androcène», «hallucination» et «affût».
Androcène
Le terme «Anthropocène» doit-il être remplacé par «Androcène»? L’âge des humains ou l’âge des hommes? La revue «Nouvelles questions féministes» se penche sur la question. L’Anthropocène, soit l’époque caractérisée par l’influence décisive de l’activité humaine sur l’évolution de la biosphère est critiquée pour sa conception indifférenciée de l’humanité. Les notions d’Anglocène et de Capitalocène ont déjà été jugées plus adéquates.
Aujourd’hui, la revue féministe propose le concept d’Androcène afin de rendre visible ce qui a été ignoré jusqu’ici: le genre de l’Anthropocène. Aborder l’Anthropocène comme un Androcène, c’est imputer la crise écologique à l’organisation patriarcale de la société, c’est responsabiliser les mâles. Qu’attendre de cette substitution langagière? Une nouvelle imputation des sources de nos problèmes permettra-t-elle de les résoudre?
Hallucination
«Non mais j’hallucine!», «C’est pas vrai, j’hallucine!», «Incroyable, j’hallucine!». L’habitude de dire «j’hallucine» se répand pour exprimer sa surprise, son étonnement ou sa stupéfaction. Une extension de sens abusive dénoncée par l’Académie française. L’occasion de rappeler qu’halluciner, c’est subir une perception sans stimulus.
Cet usage fautif progresse à une vitesse hallucinante. Pour freiner sa progression, rien de tel que la lecture de l’essai consacré aux personnes qui ont connu de véritables hallucinations. Dans «Les hallucinés» (Guérin), Thomas Vennin livre les témoignages d’alpinistes victimes d’hallucinations. En très haute altitude, leurs yeux épuisés mentent quelques fois à leur cerveau. Et c’est Jean Troillet qui voit des danseuses de ballet flotter dans l’air alors que tout un panel de personnages ou d’animaux invraisemblables est évoqué par d’autres aventuriers des cimes. Aucun n’a crié «j’hallucine». Idem pour les ultra trailers, les marins ou patients au bénéfice de psychothérapies assistées par psychédéliques. Tous connaissent des hallucinations, qu’ils taisent souvent, par peur de passer pour fou, ou narrent des années plus tard.
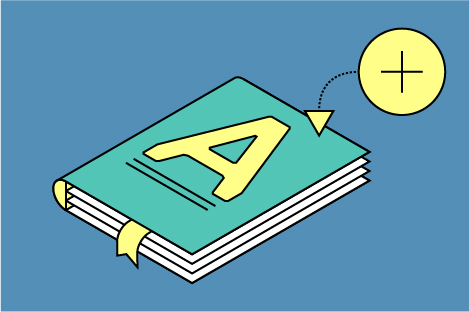
Affût
Plus question de dire que l’on cherche, que l’on attend, que l’on épie ou que l’on guette quelque chose. Se dire à l’affût de ceci ou de cela fait tellement mieux! Une expression qui fait référence à l’«affût», terme utilisé dans le milieu de la chasse pour désigner l’endroit propice où le chasseur doit se positionner afin d’attendre le gibier.
Les photographes animaliers Vincent Munier et Laurent Geslin feraient des émules. On les découvre en ce moment dans les films «La panthère des neiges» et «Le lynx». L’occasion d’éprouver les sensations des chasseurs d’images. En attendant des heures, ils font un pari qu’ils peuvent perdre. «Une posture à l’inverse de la pub et du tout, tout de suite», relève Sylvain Tesson, compagnon de Munier dans le film. L’écrivain voit dans l’affût une philosophie. Dans la patience une vertu suprême qui aide à aimer le monde. Reste à la concilier avec l’urgence climatique.


