Accéder à tous les moyens de déplacement d’une région en une seule application, c’est le principe de «Mobility-as-a-Service». Plusieurs villes européennes ont déjà déployé leurs propres solutions. Malgré plusieurs tentatives, les projets similaires en Suisse ne convainquent pas encore.
Plutôt que posséder son propre véhicule, pourquoi ne pas envisager la mobilité comme un service? C’est la question que pose, en filigrane, le concept de Mobility-as-a-Service (ou MaaS). Le principe est simple: toutes les formes de mobilité (transports publics, vélo, trottinettes électriques, taxi, mais aussi auto-partage) sont accessibles via une même application. Cette offre à la carte, adossée à un logiciel de calcul d’itinéraire, permet à l’usager de trouver en quelques secondes plusieurs options pour se rendre à destination. Le service peut être facturé à la prestation ou via un abonnement mensuel. Le modèle a déjà séduit plusieurs villes d’Europe. Berlin a lancé Jelbi en 2019. À Bruxelles, c’est Floya qui permet aux usagers d’optimiser leurs déplacements depuis 2023. À Southampton et Portsmouth, c’est l’application Breeze. À Denver, aux États-Unis, le géant Uber a étendu son offre aux transports en commun et au vélo en partenariat avec la régie locale des transports.
La Suisse en retard?
Entre 2020 et 2021, un premier projet pilote de MaaS a été conduit en Suisse alémanique: Yumuv. Les CFF se sont alliés aux transports publics zurichois (VBZ), bâlois (BVB) et bernois (Bernmobil) ainsi qu’à plusieurs prestataires privés comme Pick-e-Bike pour les vélos en libre-service, Voi pour les trottinettes électriques, et Mobility Car Sharing pour les voitures à louer. Comme à Berlin et à Bruxelles, qui disposent aujourd’hui d’un système pleinement opérationnel, c’est le développeur lituanien Trafi qui a élaboré la plateforme. Mais le projet Yumuv a été définitivement abandonné en 2024. Selon les autorités des trois villes alémaniques, les coûts de développement et d’exploitation étaient trop importants.
Pourtant, la Suisse constitue a priori un terrain idéal pour développer ces offres combinées, du fait de la robustesse de son infrastructure de transports publics. «Les tickets vendus par les CFF permettent d’effectuer n’importe quel itinéraire via différents opérateurs avec un même billet ou un même abonnement. Cela représente déjà une première esquisse de MaaS», dit Patrick Rérat, directeur de l’Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives de l’Université de Lausanne. Le fondateur de Trafi, Damian Bown, confirme que le pays dispose d’atouts décisifs. «En matière de transports publics, l’infrastructure et le service de base sont particulièrement bien développés dans les villes suisses.»
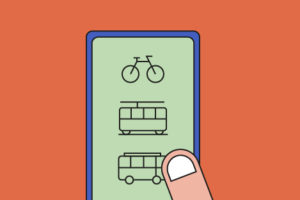
Une infrastructure de base pas assez mûre
En Suisse romande, quelques embryons de MaaS sont apparus, mais leur développement est resté relativement restreint. À Lausanne, les transports publics de la région lausannoise (TL) ont mis en place «tl+» en 2022, un abonnement qui permet de combiner transports publics et vélo. «Les expériences réalisées en Suisse alémanique ont montré qu’il était encore difficile d’intégrer tous les transports alternatifs sur une même plateforme car le transport multimodal n’est pas encore entré dans les habitudes de la population. Nous avons donc décidé de donner la priorité au vélo car c’était le moyen le plus efficace d’aborder le problème du premier et dernier kilomètre», explique Céline Walter, responsable marketing des TL. Aujourd’hui, les forfaits tl+ ne représentent que 0,2% de l’ensemble des abonnements vendus par la régie lausannoise. «L’infrastructure cyclable et le parc de vélos en libre-service locaux ne sont pas aussi développés qu’à Bâle ou à Berne, où les déplacements à vélo sont nettement plus ancrés dans la culture», ajoute Céline Walter. À Lausanne, c’est donc tout un marché de la mobilité alternative qu’il faut encore compléter. Actuellement, un projet pilote incluant les vélos électriques de la firme californienne Bird vient compléter l’offre de PubliBike dans la capitale vaudoise.
Au bout du lac, où des abonnements alliant transports en commun et vélo à prix avantageux existent également, les lignes commencent à bouger. Sous l’égide de l’Office cantonal des transports, les Transports publics genevois (TPG) et l’opérateur de vélos en libre-service Donkey Republic, désormais bien implanté sur tout le territoire cantonal, mettent en place des pôles multimodaux où se recoupent trains, trams, bus, vélos et bientôt véhicule en auto-partage. Mais la perspective d’une plateforme de MaaS réunissant tous ces acteurs n’est pas encore d’actualité, notamment parce que le marché manque de maturité. La concession des vélos en libre-service, par exemple, sera remise au concours d’ici à 2027. Or, sans un marché stable, la collaboration nécessaire entre les multiples acteurs a peu de chance d’aboutir.
L’enjeu de la coopération entre concurrents
Même en présence d’acteurs bien établis, la partie n’est pas encore gagnée. Selon Patrick Maillard, responsable innovation chez RGR, un bureau d’ingénieurs en mobilité basé à Lausanne, l’un des principaux défis à surmonter pour lancer une plateforme de MaaS, c’est de réunir toutes ces parties prenantes sous un même toit. «Pour assurer l’interopérabilité entre les différents services, les prestataires doivent consentir à partager des données en temps réel avec leurs concurrents. La plateforme de MaaS doit donc assurer une certaine équité envers tous les opérateurs, en veillant par exemple à ce que ses algorithmes ne favorisent un prestataire par rapport à un autre. Pour que le système fonctionne, toutes les parties prenantes doivent y trouver leur compte. Ces questions de gouvernance doivent être réglées en amont. Ce processus prend du temps.»
Un avis partagé par le fondateur de la plateforme Trafi Damian Bown, qui en a fait l’expérience dans plusieurs villes d’Europe: «Les négociations prennent plusieurs mois.» Pour le Britannique, il est primordial que le projet soit porté par les pouvoirs publics. «Si l’idée provient d’un acteur privé, il est peu probable que les acteurs concernés acceptent de participer. L’impulsion doit venir des autorités locales ou nationales.»


