Le français n’est pas une langue menacée. C’est ce qu’affirme le linguiste Bernard Cerquiglini, qui a participé à la magistrale «Histoire de la langue française» dont le dernier volume vient d’être publié par le CNRS. Entretien.
Voici enfin un livre qui va contre les esprits chagrins clamant sans cesse (et depuis quelques siècles) la mort prochaine de la langue française. Ah, tous les dangers qui la guettent, cette langue si pure et classique: la rue, la télévision, le franglais et aujourd’hui les messages SMS…
Le CNRS vient donc de publier le 26e et dernier tome de son «Histoire de la langue française», qui concerne les années 1945 à 2000. On y apprend que la langue de Racine n’a jamais été autant parlée dans et hors de l’Hexagone et qu’elle n’est pas plus menacée que du temps de Louis XIV où l’on adorait les italianismes.
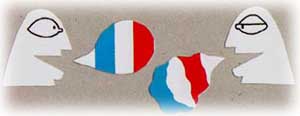
Ce 26e volume, signé de plusieurs plumes, rend compte des évolutions du français dans différents domaines (presse, mode, science) et différentes régions (France, Belgique, Québec, etc.). Un livre passionnant, souvent drôle, jamais moralisateur. Rencontre avec l’un de ses deux concepteurs, le linguiste Bernard Cerquiglini.
Largeur.com: Comment définissez-vous la mission du linguiste aujourd’hui?
Bernard Cerquiglini: C’est une activité à double face. D’une part, le linguiste doit poursuivre la recherche fondamentale, développer de nouvelles connaissances. D’autre part, il doit travailler sur le patrimoine, ce qui est une fonction sociale. Car cela implique de faire connaître et rayonner la langue, de suivre son évolution, par exemple la féminisation des mots ou les changements orthographiques, voire de créer, selon les besoins, du vocabulaire.
Le linguiste n’est donc pas celui qui défend une norme…
Non, et c’est toute la différence avec un grammairien qui, lui, défend les règles. Ce qui est estimable. Le linguistique a une autre fonction: celle de l’étude scientifique de la langue. Il ne lui revient pas de faire respecter des lois.
Que pensez-vous de l’attitude des puristes qui, tel Renaud Camus dans son livre «Répertoire des délicatesses du français contemporain» (éditions P.O.L.), s’insurgent contre le mauvais usage de la langue et en définissent un «niveau supérieur» représenté par la bourgeoisie parisienne?
Les puristes essayent de canoniser, de minéraliser la langue. Ce faisant, ils la sclérosent. Leur amour de la langue est déplacé, mortifère. La langue française évolue depuis le IXe siècle. Racine aurait pensé de la langue de Proust qu’elle est un monstre, de celle de Renaud Camus – que je n’ai pas lu – qu’elle n’a pas de sens.
En 1929, Henri Frei avait cette formule: «Les fautes d’aujourd’hui annoncent la norme de demain.» A quel moment une faute devient-elle une marque d’évolution?
Toute la question est là. Il faut considérer le français comme une langue mondiale, qui ne s’arrête pas aux frontières de l’Hexagone et encore moins à celles de Paris. Tout ce qui est dit, dans les différentes façons de parler le français, est légitime. En même temps, il y a un usage commun, autrement on ne se comprendrait pas. Donc, il y a à la fois unité et diversité, le même et l’autre. Au sein de la diversité, tout est estimable. C’est au moment où de nouvelles formes se généralisent qu’elles entrent dans l’usage. Qu’elles ne sont plus des fautes, mais la marque de l’évolution de la langue.
Vous dites que toutes les formes de français sont estimables mais, néanmoins, lorsque l’on «monte» à Paris, on essaie de gommer les tournures régionales, on s’entraîne presque à «bien» parler. En tous cas, on se surveille, parce qu’on a un peu honte de ses régionalismes.
La force du français est d’être une langue centralisée, soutenue par un état unique. Je dis que c’est sa force, parce que cela a donné naissance à un nombre incroyable de dictionnaires, de grammaires, à une littérature extrêmement riche. Evidemment, le centre en a toujours été Paris. Or le bon usage établi par la bourgeoisie parisienne n’a jamais eu beaucoup de sens pour ceux qui étaient éloignés de la capitale. Cela a créé un sentiment d’insécurité. Ceci alors que c’est l’écrasante majorité qui vit dans l’insécurité, puisque le français est plus parlé hors des frontières de l’Hexagone qu’à l’intérieur – il y a en tout 100 millions de francophones. Je rends hommage à l’institution qui défend, soutient, propage la langue. Mais je pense qu’il faut guérir les francophones de leur insécurité. Il faut lutter contre l’impérialisme d’une prétendue norme. Les Parisiens devraient se rendre compte qu’ils parlent une langue régionale – je ne vais pas me faire des amis en disant cela… Nous tous, et je suis le premier à en être conscient puisque je suis né à Lyon, nous utilisons dans notre vocabulaire 40 à 50 mots en provenance de notre région propre. Il n’y a aucune honte à cela.
Il y a le vocabulaire, il y a aussi le rythme. Les Suisses romands qui arrivent dans la capitale se sentent souvent dans l’obligation de devoir parler plus vite qu’à leur habitude…
Dans la capitale, on a depuis toujours entretenu l’athlétisme de la langue, on a cultivé son élégance, sa sveltesse. J’essaie parfois de m’imaginer Jean-Jacques Rousseau dînant avec D’Alembert et Diderot. Il devait toujours avoir trois ou quatre phrases de retard. Cela ne l’a pas empêché d’écrire quelques pages importantes de la littérature française.
Dans «L’Histoire de la langue française», il est dit que le français perd de sa popularité dans des pays comme l’Italie et l’Espagne – on peut ajouter la Roumanie – où, auparavant, il était très largement enseigné. Que pensez-vous de la décision de certains cantons suisses alémaniques dont Zurich d’enseigner à l’école primaire l’anglais avant le français, pourtant langue nationale?
Je ne veux pas prendre parti dans un débat qui concerne un pays qui n’est pas le mien. Cela dit, je pense que c’est une grande erreur, à l’aube du troisième millénaire, et surtout dans une Europe qui est par essence pluri-linguistique, de ne parler qu’une seule langue étrangère. Les médiévaux, déjà, disaient: «Timeo hominen unius linguae» (je crains l’homme d’une seule langue). L’anglais est très utile, il doit être considéré comme un outil. Si on l’enseigne en priorité, il y a de fortes chances que les élèves s’arrêtent là, se sentant exonérés de l’apprentissage d’une deuxième langue étrangère. Il faut d’abord enseigner une autre langue que l’anglais, une langue étant bien plus qu’un outil: c’est une culture, une ouverture au monde. Etre européen, c’est parler plusieurs langues. En cela, la Suisse pourrait être un laboratoire linguistique extraordinaire.
Y a-t-il une raison linguistique qui expliquerait pourquoi les francophones, de façon générale, sont peu doués pour l’apprentissage des langues étrangères?
Lorsque l’on parle français, on a le respect de la norme, une grande peur de commettre des fautes. C’est ce qui bloque les francophones. Les Américains se jettent à l’eau dès qu’ils savent quelques mots, nous, nous n’osons pas. Et, alors que les autres langues connaissent des variations d’accent, le français accentue invariablement les finales. Cela fait deux raisons, l’une symbolique, l’autre technique, qui rendent l’apprentissage des idiomes étrangers plus difficiles aux francophones.
Vous êtes un défenseur de la féminisation des noms de profession. Je n’ai rien contre. Mais il faut avouer que la «professeure» est terriblement laid à l’écrit comme à l’oral, «Madame la professeur» étant beaucoup plus élégant. Tandis que «préfette» provoque inévitablement le sourire, parce qu’on entend un diminutif. Comment faire?
Les femmes ayant maintenant accès à toutes les professions, il faut que la langue en témoigne. C’est une nécessité idéologique. Auparavant, Madame l’ambassadeur, c’était l’épouse de l’ambassadeur. C’était sa seule fonction dans la société. Nous n’en sommes plus là. Alors, évidemment, les néologismes surprennent ou font sourire. Mais on s’y habituera vite. Bientôt, on n’entendra plus que les suffixes féminins ont une valeur diminutive ou péjorative. On pourra dire la «gendarmette» sans que cela ne sonne paternaliste.
Dans «L’Histoire de la langue française», il est encore souligné qu’en France, on n’a jamais autant parlé le français parce que plus personne n’y parle uniquement une langue régionale – breton ou autre – et parce que la deuxième génération maîtrise parfaitement la langue nationale. En Suisse alémanique, par contre, on assiste à un phénomène inédit dans son ampleur. La population dans son ensemble retourne de plus en plus au dialecte, tandis que les étrangers de deuxième génération n’ayant pas suivi d’écoles supérieures parlent un langage créolisé, soit un dialecte alémanique ponctué de mots de leur langue maternelle. Ils ne possèdent souvent plus ni le Hochdeutsch, ni leur idiome maternel, soit plus aucune langue officielle. Qu’en pensez-vous?
Dans l’Hexagone, l’intégration se fait par la langue nationale. Le français des banlieues est toujours du français, il y a très peu de créolisation. L’influence arabe amène des termes qui ont leur force. Il y a une fierté de la langue des banlieues, qui est une affirmation de l’identité. Mais tous ceux qui la pratiquent possèdent aussi la langue officielle, qui est celle enseignée dans les écoles. Quant à ce qui se passe en Suisse alémanique, c’est clairement un phénomène de ghettoisation.
——-
«Histoire de la langue française», 1945-2000, CNRS Editions.
——-
Illustration: Alexia de Burgos
© Largeur.com


