La Suisse en est encore au service minimum pour l’accueil des Afghans fuyant le retour des talibans. Elle peut faire plus, sans être obligée de tomber dans la politique des portes ouvertes.
C’est un chiffre en forme de service minimum. Il a été articulé par un Ignazio Cassis «soulagé». La Suisse aura donc extirpé du chaos afghan 292 personnes, la plupart anciens collaborateurs de la coopération suisse dans le pays, ainsi que leur famille proche.
Rien donc d’une vague, ni du déferlement redouté par des «patriotes» plus pétochards que jamais. Tel Kevin Grangier, président de l’UDC vaudoise, qui oppose deux devoirs supposés de l’État, celui de sécurité et celui d’humanité, en donnant nettement la priorité à l’un: «Les élues et élus de tous les partis doivent mener des politiques qui garantissent la sécurité des Suissesses et des Suisses…» Tandis que «sur le plan humanitaire, il ne faut pas céder aux appels à la bonne conscience». La «menace principale»: «le terrorisme».
Il ne semble pas incongru pourtant, vu le très petit nombre de personnes concernées, de supposer le risque à peu près inexistant, ni de penser la procédure de tri adéquate. Le Conseil fédéral a expliqué que les Afghans exfiltrés de Kaboul qui «recevront automatiquement le statut de réfugié sans avoir besoin de passer par les procédures d’asile habituelles ont été contrôlés une première fois lors de leur engagement par la Confédération à Kaboul», puis une deuxième fois par le Service de renseignement de la Confédération «à leur arrivée à Zurich». Si besoin, «un troisième contrôle pourrait être fait “au cas par cas” dans un des centres d’enregistrement».
Sur un point pourtant, les frileusement sécuritaires n’ont pas complètement tort. Kevin Grangier juge ainsi qu’il ne faut «pas sous-estimer les problèmes d’intégration, de modes de vie, d’islamisation ou les règlements de comptes entre diasporas» que les réfugiés «importeront avec eux» et qui «engendreront d’immenses défis sécuritaires, scolaires, sociaux et financiers».
La réalité pour une fois ne vient pas contredire complètement les diatribes bêtement politiciennes. Dans l’unité ambulatoire du programme santé migrants des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), les Afghans, nous apprend Le Temps, «représentent la moitié des patients». Avec comme principal motif de consultation: «le stress post-traumatique», explique Sophie Durieux-Paillard, responsable du programme. «Près de 90% de nos patients afghans présentent une comorbidité psychologique. Un simple uniforme, d’un contrôleur des transports publics par exemple, peut raviver le traumatisme lié à des violences commises par des soldats.» Autres symptômes: les troubles du sommeil, de l’appétit ou de la mémoire, «particulièrement handicapant lorsque les migrants tentent d’apprendre le français».
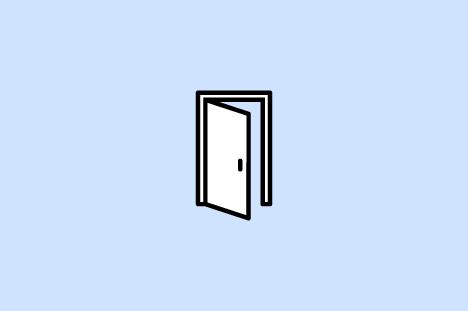
L’association de défense des droits de l’homme, Human Right Watch, avait alerté en 2019 déjà sur la santé mentale des Afghans, considérant «qu’une personne sur deux souffrait de problèmes psychologiques». Un taux deux fois supérieur à celui estimé par l’OMS pour la population de pays en guerre.
Autre témoignage, toujours dans Le Temps, celui de Maryam Yunus Ebener, première femme d’origine afghane à siéger dans un exécutif romand (à Onex), et arrivée en Suisse à l’âge de 8 ans avec sa famille. Elle raconte avoir d’abord été d’entrée «frappée par la grande liberté, l’absence de pudeur entre les hommes et les femmes». Et que la suite n’a pas été vraiment simple: «On sous-estime souvent le poids de la loyauté dans les communautés patriarcales. Personnellement, j’ai dû batailler auprès de ma famille pour m’émanciper. A la maison, mes frères n’étaient pas logés à la même enseigne que mes sœurs et moi.»
Tous ces problèmes annoncés n’ont rien de vraiment insurmontables et la société suisse semble avoir les moyens d’y faire face et d’accueillir donc, au-delà du très petit nombre actuel, un contingent raisonnablement plus étoffé de réfugiés afghans.
A condition de ne pas tomber dans l’accueil sans condition que semblent réclamer la gauche et les associations, le PS articulant même un chiffre tombé du ciel et à usage sans doute purement militant, de 10 000 Afghans à recevoir. Ou pire, comme cette naïve suggestion d’un chargé d’information sur l’asile au Centre social protestant: «Il est difficile d’articuler un chiffre du nombre de personnes à accueillir. Peut-être pourrait-on agir avec un peu d’éthique et faire le compte après?»
Ce qui serait le meilleur moyen de donner de vrais arguments à ceux qui ne savent que claquer les portes au nez.


