Certains bilans de santé restent essentiels pour dépister des maladies de manière précoce, mais ceux effectués de manière systématique sont aujourd’hui remis en question. Inutiles voire néfastes, ils augmentent les risques de surdiagnostic.
«Tout homme bien portant est un malade qui s’ignore», écrivait l’écrivain français Jules Romains en 1923, dans sa pièce de théâtre Knock ou le triomphe de la médecine. Cette idée est aujourd’hui au cœur des bilans de santé annuels. Test d’effort, mesure de la capacité pulmonaire, dépistage du cancer de la thyroïde ou encore scanner du corps entier: ces contrôles systématiques visent à détecter un problème de santé le plus précocement possible chez des personnes asymptomatiques.
Néanmoins, bien que certains dépistages soient utiles, plusieurs études scientifiques, dont une publiée cette année dans le Journal of the American Medical Association, ont démontré que ces «check-up» effectués sur des individus en bonne santé n’améliorent ni leur qualité ni leur durée de vie. Pire encore, un test de dépistage peut avoir des répercussions importantes. En cherchant des maladies à l’aveugle, les patients risquent le surdiagnostic. «Ce phénomène est la conséquence d’une médecine hautement technologique capable de détecter d’infimes anomalies, explique Arnaud Chiolero, professeur de santé publique au laboratoire de santé des populations de l’Université de Fribourg. Le surdiagnostic n’est ni une erreur ni un faux positif, mais l’identification d’une véritable anomalie chez des personnes sans symptômes (incidentalome).» Il est alors question de déterminer si cette anomalie va évoluer par exemple en cancer agressif ou croître lentement et ne jamais altérer la vie du patient.
Dans la pratique clinique, «l’usage excessif des tests de dépistage complique et peut avoir un impact préjudiciable sur la prise en charge du patient, analyse Marie Méan, médecin associée au sein du Service de médecine interne du CHUV. En effet, la multiplication des examens augmente les coûts de la santé – tout comme le risque de résultats faussement positifs et/ou d’incidentalomes –, peut créer un stress psychologique consécutif et vampirise les patients en leur prenant du sang à répétition.» Pour Arnaud Chiolero, c’est un problème majeur, «car le surdiagnostic aboutit à un surtraitement qui n’apporte aucun bénéfice au patient, mais qui peut être source d’effets secondaires et de complications».
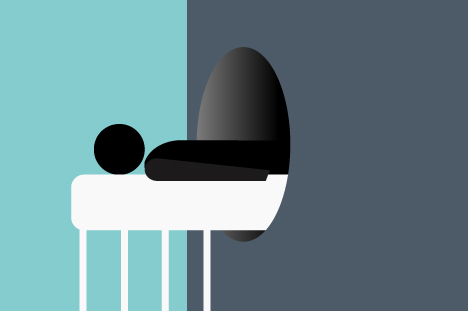
Opérations inutiles
En 2016, une étude du Centre international de recherche sur le cancer révélait que 70% des cas de cancer de la thyroïde dans les pays développés seraient surdiagnostiqués. Des centaines de milliers de thyroïdes auraient alors été enlevées pour rien, contraignant des patients à des traitements médicamenteux à vie. De nombreuses anomalies sont en effet découvertes de manière fortuite par imagerie médicale.
Le vif débat public concernant l’efficacité de la mammographie et son risque de surdiagnostic illustre cette problématique. Le dépistage du cancer du sein est efficace, puisqu’il permet la réduction du risque de mortalité de 20%, selon la Revue médicale suisse. Par contre, la mammographie expose les femmes à des surtraitements. Ainsi, selon une étude anglaise publiée dans la revue scientifique The Lancet en 2012, pour 180 dépistages du cancer du sein, un décès sera évité, mais 19% de ces femmes seront surdiagnostiquées. Les patientes doivent donc évaluer le rapport bénéfice/risque avec leur médecin en fonction de leur historique personnel.
Autre exemple: pour une étude, des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego ont fait passer un CT-scan du corps entier à 1’192 personnes sans problème de santé particulier. Ils ont découvert que 86% des scans présentaient des irrégularités, avec une moyenne de plus de deux par personne. «Beaucoup d’individus peuvent avoir des anomalies dans le corps. Le problème est qu’une fois identifiées, il n’est plus possible d’ignorer leur présence, souligne le professeur Jacques Cornuz, médecin-chef et directeur général d’Unisanté, à Lausanne. Le besoin des patients d’être rassurés, combiné au souci des médecins de ne pas manquer une maladie représentent deux sources de surdiagnostic.»
Avec le cancer de la thyroïde et l’embolie pulmonaire, le cas du dépistage du cancer de la prostate comporte aussi un risque de surdiagnostic. En effet, 30 à 70% des hommes âgés de plus de 60 ans auraient une tumeur de la prostate, dont la plupart qui resteraient longtemps bénignes. Selon une étude du centre américain de contrôle des maladies publiée en 2016, sur 1’000 hommes qui seront dépistés pendant dix ans, un seul sera sauvé d’un décès du cancer de la prostate grâce au dépistage. Par contre, au moins 30 hommes seront traités pour rien et risquent l’incontinence, l’impuissance ou des problèmes cardio-vasculaires à cause du traitement. «Le personnel médical doit désormais engager un dialogue avec le patient pour lui expliquer les avantages et les risques des dépistages, conseille Arnaud Chiolero, professeur de santé publique à Fribourg. Une fois l’anomalie découverte, lorsqu’il y a de grands risques de surdiagnostic et donc de surtraitement, une possibilité est de suivre de près son évolution – on parle alors de surveillance active – afin de ne pas se précipiter sur une opération.»
Dépistages efficaces
Tous les dépistages ne sont pourtant pas inutiles. Certains examens restent plébiscités, comme le dépistage du cancer colorectal chez les femmes et les hommes, effectué par une recherche de sang occulte, c’est-à-dire du sang invisible à l’œil nu, dans les selles (une fois tous les deux ans) ou une coloscopie tous les dix ans, entre 50 et 75 ans. Le cancer du sein pour les femmes est également surveillé tous les deux ans entre 50 et 74 ans, ou avant s’il existe des prédispositions familiales (voir l’encadré). Ces bilans sont remboursés par l’assurance de base entre 50 et 70 ans.
Si un bilan lipidique est recommandé dès 40 ans, les dépistages du diabète et de l’ostéoporose le sont surtout pour les personnes ayant des facteurs de risques, soit par hérédité, soit dus à leur style de vie, comme dans le cas d’un excès de poids. «Les demandes de check-up s’avèrent souvent motivées par ’ l’agenda caché ’ du patient, constate le Prof. Jacques Cornuz. Cela peut être un collègue qui a eu le cancer de la prostate, ou un voisin dépisté pour une hépatite. Les patients viennent avec des craintes qu’ils ne disent pas au premier abord, mais auxquelles il faut répondre.»
Le programme national de prévention clinique EviPrev, qui réunit cinq centres académiques de médecine interne générale (Lausanne, Berne, Genève, Bâle et Zurich), a publié les recommandations suisses en matière de bilan de santé. Celles-ci priorisent les interventions de prévention et de dépistage non seulement en fonction des facteurs de risque et de l’âge des patients, mais également selon leur niveau d’efficacité. « Les bilans de santé représentent aussi un prétexte particulièrement utile pour discuter du comportement des patients, de leur consommation d’alcool, de tabac, des dangers d’une sexualité à risque, souligne Jacques Cornuz. C’est un moyen efficace et prouvé de prévenir de nombreuses maladies en amont.» /
_______
Pour une médecine intelligente
Inspiré de la campagne Choosing Wisely lancée en 2011 aux États-Unis, le mouvement Smarter Medicine Suisse lutte contre les examens inutiles en milieu clinique. Des médecins ont ainsi établi des listes de tests à l’utilité contestée ou carrément inutiles. En Suisse, ce sont des listes de cinq tests par spécialité qui ont été déconseillés. Pour Marie Méan, médecin associée au service de médecine interne du CHUV: «Tout examen doit être réalisé uniquement si son résultat a une influence prouvée sur la prise en charge du patient.»
_______
Une version de cet article réalisé par LargeNetwork est parue dans In Vivo magazine (no 19).
Pour vous abonner à In Vivo au prix de seulement CHF 20.- (dès 20 euros) pour 6 numéros, rendez-vous sur invivomagazine.com.


