Les divisions entre féminisme de gauche et féminisme de droite, apparues à l’occasion de la grève des femmes, servent d’autant moins la cause qu’elles reposent sur du sable et de la vaine idéologie.
C’est évidemment très regrettable, mais guère contestable: à l’occasion de la cuvée 2023 de la grève des femmes, on a davantage parlé de divisions que d’avancées de la cause. Davantage de «féminisme de droite» et de «féminisme de gauche», que de féminisme tout court, les unes et les autres se renvoyant la balle de la discorde.
Discorde qui a pu s’observer au plus haut niveau: sur les trois conseillères fédérales en exercice, seule la socialiste Elisabeth Baume-Schneider a daigné participer à la manifestation. Discorde qui s’est retrouvée, la journée même, au Conseil des Etats où l’on a pu entendre la centriste Isabelle Chassot expliquer sa non-participation à la grève par des revendications qui cette année iraient «trop loin» alors que «les résultats» seraient «déjà là». Ce qui était d’autant plus facile à dire pour elle, qu’elle vient d’être élue à la présidence très convoitée de la Commission d’enquête parlementaire sur la débâcle de Credit Suisse.
A quoi la socialiste Mathilde Crevoisier Crelier rétorquait, que «demander l’égalité salariale» n’avait rien d’«extrême».
Le problème semble pourtant que les slogans du 14 juin ne se sont pas limités à cette juste revendication, basée sur des discriminations chiffrables et indiscutables, mais ont dérivé globalement vers une équation plus douteuse: identifier féminisme et anticapitalisme.
Alors qu’il semble bien que c’est encore dans les démocraties que la cause des femmes est la mieux défendue, – demandez aux Iraniennes ou aux Afghanes, ou comptez le nombre de femmes dans le comité central du parti communiste chinois ou au Kremlin – et que toutes les démocraties, sans exception, s’inscrivent dans le système capitaliste.
Ancienne collaboratrice d’Alain Berset, et aujourd’hui journaliste au Temps, Nicole Lamon décrit assez justement le désolant de la division et la vanité des positions idéologiques quand il s’agit de la cause des femmes: «Nul besoin d’être partisane encartée ou militante colorée pour fustiger les inégalités salariales et les violences domestiques, pour espérer davantage de femmes dans les échelons supérieurs de l’économie, ou un meilleur partage des tâches à l’arrivée d’un enfant.»
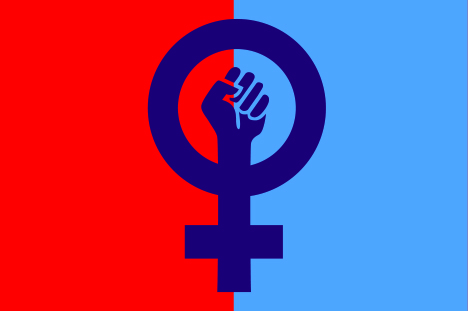
Avec au final cette image assez désastreuse à l’heure des JT. «Il y avait quelque chose de déroutant, ce 14 juin à 19h30 sur la place Fédérale, à scruter la sortie des parlementaires: la liesse des élues de gauche qui se ruent dans la manif, l’empressement de celles de droite à s’esquiver.»
On pourra en effet trouver le match, hélas, nul. Les «féministes de gauche» ont sans doute eu tort de surcharger la barque à ce point. Surcharge résumée dans le slogan principal, la sauce Unia, imprimé sur les t-shirts: «Du respect, du temps, de l’argent». Ceci a pu être ainsi traduit négativement, du côté des femmes bourgeoises: gagner plus tout en travaillant moins, et espérer pour cela davantage de considération. Les «féministes de droite», elles, auraient pu sans doute se braquer moins rapidement et participer à la fête en fermant discrètement, et bienveillamment, les yeux sur certains slogans outranciers mais minoritaires, et de peu de portée du fait même de leur outrance.
Que le féminisme ne soit d’aucun bord est assez démontré par le spectre politique: du parti radical à la gauche et l’extrême gauche, en passant par le centre, chacune des formations défend, à sa manière, et avec de vraies nuances et différences de sensibilité, la cause des femmes.
Seule l’UDC, par ses votes et la faible représentation d’élues dans ses rangs, apparait comme une formation qu’on osera difficilement qualifier de féministe. C’est ainsi le seul parti gouvernemental qui n’a pas, et n’a jamais eu, de représentante au Conseil fédéral. C’est aussi le seul parti ouvertement, ou sournoisement, pro-russe. Mais ceci est une autre histoire, à défaut d’être une vraie coïncidence.


