Certains s’offusquent que les Ukrainiens soient mieux accueillis que d’autres réfugiés, en oubliant que les migrations n’obéissent pas qu’à des principes désincarnés.
Une assez vilaine musique, pour ne pas dire un odieux soupçon, est en train de monter à propos de l’accueil des Ukrainiens en Suisse. On leur déroulerait, se murmure-t-il ici et là, le tapis rouge, contrairement à d’autres requérants d’asile reçus avec nettement moins d’enthousiasme. Notre générosité, en bref, serait à géométrie variable.
On en est à calculer les kilomètres, à trouver que finalement Alep est à peine plus éloignée de Berne que Kharkiv. Que donc, la cote de popularité dont bénéficieraient les réfugiés ukrainiens serait moins due à la proximité géographique qu’au fait qu’ils soient plutôt blancs et censément de culture chrétienne.
Et tant pis s’il existe des raisons plus honorables au préjugé positif qui entoure à l’heure actuelle les foules fuyant l’Ukraine massacrée. Comme celle avancée par Etienne Piguet, vice-président de la Commission fédérale des migrations: «On a clairement une agression étrangère d’un pays pacifique, avec des victimes identifiables. Cette lisibilité donne une légitimité au besoin de protection.»
Ou cette autre raison, avancée par Rosita Fibbi, sociologue au Forum suisse pour l’étude des migrations de l’Université de Neuchâtel: «La guerre en Ukraine est un conflit intelligible, entre deux pays dont la souveraineté est reconnue. La situation est très différente de celles au Yémen, en Éthiopie ou en Syrie, où l’on assiste à des affrontements entre groupes rivaux. Cet aspect explique en large partie la différence d’accueil de la population.»
Et ce sans parler du fait que ce sont surtout des femmes et des enfants qui constituent le gros des fuyards ukrainiens. Que les hommes soient majoritairement restés sur place pour se battre, cela atteste de la réalité de la guerre et du danger, et achève de faire décidemment apparaître les Ukrainiens comme des réfugiés pas tout à fait comme les autres. Impossible avec eux de supposer à leur fuite des motivations avant tout économiques, comme ce peut être le cas pour des groupes de migrants où les hommes jeunes sont en écrasante majorité.
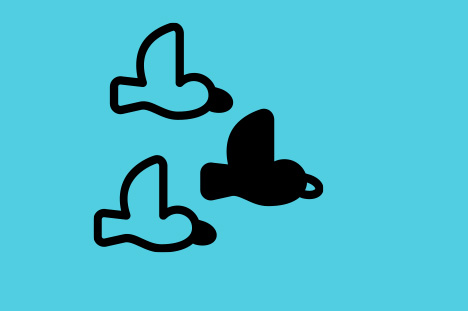
Difficile de nier aussi une évidente proximité idéologique: on est naturellement plus enclin à ouvrir ses portes à des gens dont il est clairement établi qu’ils appartiennent à une démocratie assaillie par une tyrannie. Les victimes des dictatures communistes, qu’elles soient tibétaines ou tchécoslovaques, ont par le passé bénéficié de la même sympathie qu’aujourd’hui les Ukrainiens.
Il semblerait que cet accueil différencié suivant l’histoire, la culture, l’origine et les motivations soit plutôt mal compris chez les migrants eux-mêmes. Une porte-parole de l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) a ainsi pu raconter: «La situation actuelle suscite l’émoi parmi nos bénéficiaires. Certains d’entre eux prennent peur, et nous interpellent car ils pensent qu’on va les déloger pour confier leurs places à des Ukrainiens.»
Ce qui ne sera évidemment pas le cas. Et puis serait-il vraiment si scandaleux que les Ukrainiens tirent bénéfice du fait plus ou moins avéré qu’ils nous ressemblent un peu plus que d’autres? Les migrations, l’accueil de l’étranger, comme toutes les situations humaines, ne peuvent être ramenés à de froides rencontres indifférenciées entre robots sans états d’âmes et régies seulement par des principes désincarnés, aussi généreux soient ils.
Le professeur Etienne Piguet, dans «Le Temps», remet ainsi assez justement les pendules à l’heure à propos du bon accueil fait aux Ukrainiens: «On doit plus se réjouir que ce genre de mécanisme d’hospitalité fonctionne plutôt que de se lamenter du fait qu’il soit moins généralisé et tributaire de la distance. C’est une illusion que de croire que l’on peut transcender toutes les barrières de compréhension et d’empathie.»


