Presque chaque village avait autrefois sa propre décharge d’ordures ménagères. Enfouies il y a des décennies, elles peuvent refaire surface et rendre un assainissement nécessaire. Exemples à Fanas, dans les Grisons et à Mauren-Berg, en Thurgovie.
Une version de cet article réalisé par Large Network est parue dans le magazine L’Environnement. Abonnez vous gratuitement ici.
_______
En février 2021, après une longue période de précipitations et un glissement de terrain, la forêt située en bordure de Fanas, un village de montagne des Grisons, s’est retrouvée submergée de déchets: pots de yaourt, bouteilles en verre, canettes, sacs plastique, emballages de toutes formes et couleurs et même une vieille cuisinière. Soit tout ce que les habitants de Fanas avaient jeté dans la décharge de Rälia jusqu’en 1976, avant la collecte des déchets. Depuis cette date, les ordures ménagères sont acheminées à l’usine d’incinération de Fanas et la décharge de Rälia, fermée, puis recouverte de déblais et de gravats. Les ordures ont vite été oubliées et sont restées, pendant des décennies, cachées sous la terre et la végétation. Jusqu’à ce que les pluies les fassent remonter à la surface en février 2021. «Les sacs plastiques colorés avaient l’air d’avoir été jetés la veille, raconte Rahel Egli, responsable des sites contaminés à l’Office de la nature et de l’environnement pour les Grisons. C’était impressionnant de voir à quel point le plastique est persistant.»
Quand les déchets ménagers deviennent toxiques
À l’époque, les petits villages étaient souvent équipés de décharges de ce type. La Suisse compte, actuellement, près de 14800 sites de stockage considérés comme pollués. Parmi ces sites, environ 2% doivent faire l’objet d’un assainissement, car ils représentent une menace pour les eaux de surface et souterraines ou la qualité des sols et de l’air. Jusqu’à il y a vingt ans les matières organiques telles que les déchets verts et de cuisine, le papier ou les restes de bois étaient jetés dans ces décharges. «En l’absence d’air, la décomposition des matières organiques entraîne la formation d’ammonium, qui est toxique pour les organismes aquatiques », explique Christoph Reusser de la section Sites contaminés de l’OFEV. Suivant la composition des déchets, d’autres substances nocives pour la santé humaine et animale, telles que les métaux lourds, les composés organochlorés ou les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), peuvent se retrouver dans l’environnement.
Apparition de nouveaux sites
«Par chance, à la décharge de Rälia, les concentrations critiques en substances nocives n’ont jamais été atteintes», précise Rahel Egli. Initialement, le site ne nécessitait donc pas d’assainissement. Cependant, à cause de la résurgence de déchets, le site a dû être traité. La décharge a été entièrement excavée afin d’éviter que d’autres déchets réapparaissent et se retrouvent dans le ruisseau en contrebas.
Rahel Egli raconte que les travaux sur ce terrain difficile d’accès, pentu et densément boisé n’étaient pas une mince affaire. «Par endroits, l’excavatrice ne pouvait plus avancer. Il a fallu ramasser les déchets à la main.» Les travaux de déblaiement et d’excavation des matériaux de décharge ont duré deux semaines. 200 tonnes de déchets, blocs de gravats, bois et restes végétaux ont été retirés. «Comme il était impossible de tout trier sur place, on a dû envoyer les matériaux dans une installation de lavage des sols située en Thurgovie. Une démarche particulièrement coûteuse.» L’assainissement de la décharge de Rälia a coûté plus de 100000 francs. La Confédération a pris en charge 40% de ces coûts, comme cela est prévu pour l’assainissement des décharges de déchets urbains.
Ce genre de situations pourrait se multiplier à l’avenir, selon Christoph Reusser, de l’OFEV. Car qui dit changement climatique, dit augmentation des épisodes de fortes précipitations, des phénomènes de crue et des problèmes d’érosion. «Nous devons nous attendre à ce que d’autres sites, qui n’étaient jusqu’à présent pas considérés comme nécessitant un assainissement, deviennent problématiques.»
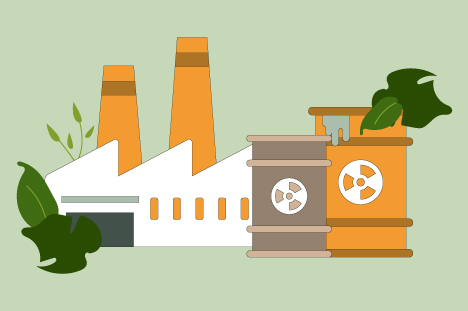
En bref: Jusque dans les années 1990, il était courant de déposer les ordures ménagères dans des décharges à ciel ouvert situées en pleine nature. Des dizaines d’années plus tard, certaines de ces anciennes décharges deviennent des sites contaminés qui menacent l’environnement et dont l’assainissement coûte souvent très cher
_______
Un ruisseau contaminé
Pendant de nombreuses décennies, le Kehlhofbach était à peine visible sur le territoire de la commune de Mauren-Berg en Thurgovie. En effet, au début des années 1960, le ruisseau a été canalisé dans un tuyau souterrain sur un long tronçon afin d’utiliser le ravin comme décharge. «Cette pratique était courante à l’époque», indique Thomas Back, responsable suppléant Déchets et sols à l’Office de l’environnement du canton de Thurgovie. «Dès que le ravin était rempli d’ordures, le tout était recouvert de terre et on obtenait une surface plane, destinée ensuite à l’exploitation agricole», ajoute-t-il. C’est le cas de la décharge de Geeren où l’herbe a recouvert les déchets ménagers et les gravats déposés par les quatre communes limitrophes entre 1961 et 1970.
Mais les ordures ont laissé des traces encore visibles des décennies plus tard: une fois la décharge fermée, là où le Kehlhofbach refaisait surface, il était pratiquement dépourvu de vie. Les analyses effectuées en 2006 dans le cadre de l’investigation préalable des sites contaminés ont révélé la présence de grandes quantités d’ammonium et de plomb dont les concentrations dépassaient largement les seuils fixés par l’ordonnance sur les sites contaminés. «Au fil des années, la canalisation n’était plus étanche, l’eau polluée par les déchets en décomposition pouvait donc s’infiltrer dans le ruisseau», explique Thomas Back.
La décharge de Geeren a donc été classée comme site contaminé. Les travaux d’assainissement ont commencé en 2012. Il a été possible de renoncer à l’excavation des quelque 40000 à 60000 mètres cubes de matériaux de décharge. Au lieu de cela, la partie enterrée du ruisseau a été ramenée à la surface pour contourner la décharge. «Nous avons également capté l’eau d’infiltration contaminée afin de l’amener directement à la station d’épuration et d’éviter qu’elle n’entre en contact avec l’environnement», ajoute Thomas Back. Ces mesures ont coûté près de 1,1 million de francs, mais une excavation complète aurait coûté beaucoup plus de temps et d’argent. Après environ un an de travaux, le ruisseau était complètement séparé de la décharge. Comme l’ont montré plusieurs études, le cours d’eau s’est rétabli depuis et la vie est revenue dans le Kehlhofbach.


