L’assouplissement des mesures sanitaires trahit surtout une lassitude générale. Comme si un virus qui n’intéresse plus, perdait automatiquement de sa dangerosité.
C’était donc «une belle journée». Admettons, puisque c’est le président de la Confédération Ignazio Cassis qui le dit. Une journée qu’on voudrait bien faire entrer dans l’histoire comme celle du début de la fin. Avec ce petit air entêtant, que semblent siffloter depuis quelques semaines toutes les lèvres médiatiques et politiques: le Covid, c’est fini.
La lumière n’est plus au bout du tunnel, comme métaphorisé jusqu’à la scie pendant deux ans, mais cette fois carrément -c’est toujours Cassis qui souligne-, dressée à l’horizon. Un vrai soleil d’Austerlitz.
Il ne s’agit pourtant, dès ce 3 février vite proclamé historique, que de supprimer l’obligation du télétravail -pas le télétravail lui-même évidemment-, ainsi que l’obligation de quarantaine pour les cas contacts. Des broutilles donc. La preuve: même la sourcilleuse et pétocharde task force est pour une fois d’accord avec l’assouplissement.
Pour le reste, la vraie libération, le vrai retour à une vraie vie normale, il faudra attendre encore un peu. Vraie vie normale qui, lorsqu’elle l’était encore, ne paraissait pourtant pas si merveilleuse. Rappelez-vous, les mécontents étaient au moins aussi nombreux qu’aujourd’hui.
Pour faire patienter les foules trépidantes, deux scénarios sont proposés: l’un optimiste avec la fin de toutes les mesures, y compris le pass sanitaire et le port du masque. L’autre, plus prudent, consiste en un «assouplissement par étapes». Il est vrai que ce début de la fin se profile dans un contexte où la plupart des chiffres sont pourtant encore au rouge vif. Mais pas le seul qui compte désormais, celui des admissions en soins intensifs.
Remarquons que pendant deux ans ce même chiffre a souvent été grossièrement minimisé, quand pas dissimulé. Sans doute par peur que le peuple, toujours aussi peu subtil, finisse par ne pas prendre au sérieux cette pandémie.
Notons aussi que ce même peuple n’est pas descendu dans la rue pour manifester son enthousiasme et son allégresse face à la fin présumée de la crise sanitaire. C’est plutôt l’indifférence générale qui prédomine. Comme si l’affaire avait fini par définitivement lasser. Comme si la fin de la pandémie était due autant au peu de virulence des nouveaux variants qu’au manque d’intérêt désormais des foules.
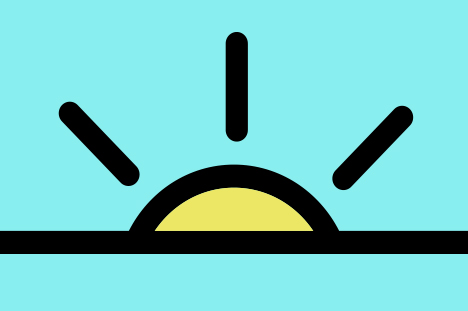
Alain Berset, déjà à l’heure du bilan, en a profité pour se plaindre d’avoir, deux ans durant, toujours été pris entre deux feux contradictoires de critiques: ceux qui voulaient toujours tout fermer et ceux qui voulaient toujours tout ouvrir. Ce qui lui permet, dans la foulée -quitte à récrire un peu l’histoire-, de dépeindre le Conseil fédéral comme une sorte de monstre froid ne s’étant jamais laissé guider dans ces décisions que par les faits, rien que les faits, et la raison, rien que la raison. Comme les otaries, on n’est jamais mieux applaudi que par soi-même.
Hormis pour l’UDC, qui a toujours flirté avec une quasi négation de la pandémie, et les organisations professionnelles dont les intérêts ont été durement impactés, genre GastroSuisse, c’est le scénario le plus prudent qui semble tenir la rampe, défendu par la plupart des ministres cantonaux de la santé et des partis politiques.
Comme si le politique avait peur de perdre un peu trop vite le surcroît de prérogatives que l’urgence sanitaire lui avait octroyé. Ainsi, selon le ministre de la santé jurassien Jacques Gerber: «Le taux d’incidence demeure élevé. Dans ce contexte, lever toutes les mesures à la fois me semble être un risque trop grand à prendre.»
Dans le camp d’en face on ressort, à l’inverse, les vieux réflexes libéraux, à la manière du Centre patronal vaudois: «Un allègement progressif nous fait craindre de la finasserie administrative.»
Ce qui est sûr, c’est que la grande inversion a bien eu lieu, comme l’a expliqué l’éthicien Johan Rochel dans l’émission radio «Forum»: «Chaque jour qui passe, c’est le maintien des mesures sanitaires qui devra être un peu plus fortement justifié et solidement argumenté, et non leur suppression, qui elle désormais, va sans dire.»


