Vous avez des enfants, un ménage à tenir, et vous vous occupez de vos parents ou grands-parents à côté d’un travail exigeant? Vous venez d’atteindre la retraite tant attendue, mais partagez vos semaines entre les soins à votre maman très âgée et la garde de vos petits-enfants? Vous vous demandez régulièrement: quand est-ce que je m’occupe de moi? Alors vous faites partie de la «génération sandwich». Un concept apparu il y a déjà quelques décennies, mais qui prend, en ce début de XXIe siècle, une nouvelle ampleur. Et invite à une réflexion passionnante sur notre conception de l’individu et de sa liberté.
Le terme désigne, en réalité, davantage un âge de la vie qu’une génération telle que les baby-boomers (1945-1965) ou les X (1965-1980) – qui constituent précisément le gros du «club sandwich» actuel. Un âge, qui peut aller de la trentaine à la soixantaine bien engagée, pendant lequel une personne s’occupe en même temps – que ce soit par les soins, en assurant une présence ou financièrement – de proches plus âgés et d’enfants (ou de jeunes adultes). C’est le cas de l’architecte nyonnais David Prudente, 43 ans et papa d’une fille de 2 ans. Il rend très régulièrement visite à son père, veuf, de 81 ans: «Je le fais volontiers, même si je ne me sens pas obligé. Mais si je ne le vois pas pendant une semaine, il me dit: on ne se voit plus!»
Prendre soin de ses proches, des petits comme des âgés, est vieux comme le monde. Pourquoi en parler davantage aujourd’hui? Chercheuse à l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source – HEDS La Source VD, Annie Oulevey Bachmann a consacré sa thèse en sciences infirmières au maintien de la santé dece qu’elle préfère appeler la «génération pivot». Pour cela, elle a interrogé 844 employés d’une administration publique suisse, âgés de 45 à 65 ans. Son enquête révèle un faisceau de conditions nouvelles qui déterminent l’ampleur actuelle du phénomène sandwich.
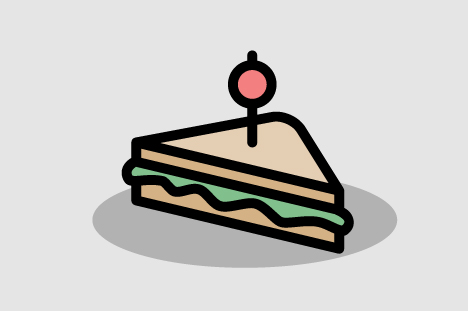
Les proches de plus en plus sollicités
L’allongement de la durée de vie, d’abord. Aujourd’hui, il n’est plus rare qu’une seule génération sur quatre cotise au système social dans une même famille. Surtout, au-delà de la question de la solidarité financière, le vieillissement implique de plus en plus les «proches aidants» dans les soins quotidiens. En ce sens, les politiques publiques de promotion du maintien à domicile, qui visent à limiter l’augmentation des coûts de la santé, ont un effet double, note Annie Oulevey Bachmann. «Si les politiques mettent en place tout un système de soutien, comme des soins à domicile de qualité, le virage ambulatoire qui consiste à renvoyer les patients le plus vite possible à la maison accentue la pression sur l’entourage, qui est plus sollicité.»
Or ces proches, conjoints, enfants ou amis, ont des vies très actives et bigarrées, bien éloignées des modèles familiaux traditionnels. Ils ont eu, par exemple, des enfants tardivement, ce qui provoque un chevauchement plus grand entre l’éducation des petits et le soutien aux vieux parents. Certains ont des enfants déjà adultes d’un premier mariage, dont ils paient les études, mais aussi des bébés issus de leur couple actuel, nécessitant un tout autre engagement. D’autres encore doivent verser une pension alimentaire ou ne peuvent pas compter sur l’aide d’un conjoint à la maison. Mobilité et migrations obligent, ces personnes ont peut-être de grandes distances à franchir pour rejoindre leur travail ou le domicile de leurs parents. Enfin, il est possible qu’elles encourent des pressions importantes dans le cadre de leur activité professionnelle.
A ces tendances s’ajoutent des facteurs de stress liés, dans certains pays, à la conjoncture économique, qui donne à la famille ce que le sociologue français Serge Guérin a nommé un «rôle d’amortisseur de crise». Annie Oulevey Bachmann a ainsi observé, dans son étude, que «certains employés envoyaient de l’argent en Espagne ou au Portugal, à leurs parents, dont les retraites avaient diminué drastiquement». Quant aux jeunes, la crise retarde encore plus leur émancipation: en Espagne, où 51% des moins de 25 ans sont au chômage, huit jeunes de moins de 30 ans sur dix vivent toujours chez leurs parents.
Des semaines de 72 heures et un stress élevé
Comment tout cela se traduit-il en termes horaires? Les 23% des personnes interrogées par Annie Oulevey Bachmann qui tombent dans la catégorie sandwich consacrent en moyenne 27 heures par semaine à la charge domestique et familiale, dont 6 aux enfants et/ou petits-enfants, et 6 heures au soin de proches vieillissants. Pour une charge de travail totale, activité professionnelle incluse, de 72 heures par semaine en moyenne. Dans l’une des rares autres études comparatives sur la génération sandwich, conduite au Canada sur des chiffres de 2002, 70% de ses membres disaient ressentir un stress «très élevé ou plutôt élevé», contre 61% des personnes ne s’occupant ni d’enfants ni d’aînés. Et pour beaucoup d’entre elles, ce rôle impliquait des dépenses supplémentaires (40%), des activités sociales modifiées (36%), ou des projets de vacances remaniés (26%).
Etre ainsi «pris en sandwich», est-ce pour autant risquer l’étouffement existentiel? Pas si sûr. La même étude canadienne, mais aussi celle conduite par le Pew Research Center aux Etats-Unis en 2012 montrent qu’être membre de la génération pivot n’a aucune influence sur la satisfaction générale des personnes. Dans ses recherches, Annie Oulevey Bachmann a constaté qu’il n’y avait pas de lien direct entre la coexistence des charges et une moins bonne santé de l’individu. «Avoir à gérer enfants et activité professionnelle et conjoint et parents, cela peut aider à structurer son quotidien, à mettre des limites. A condition d’être capable de prendre du recul, de ne pas se surengager.»
Mieux, ce rôle de soutien peut même augmenter l’estime de soi, en donnant au proche aidant le sentiment de développer ses compétences, tout en trouvant un sens à sa vie. «Mais attention, prévient la chercheuse lausannoise. Il peut être gratifiant de s’occuper des gens, cela ne veut pourtant pas dire que dans dix ans, l’accumulation d’hormones de stress ne provoquera pas d’ennui de santé. Or beaucoup d’études montrent que si on prend soin de soi vers 45-60 ans, on sera en meilleure santé plus tard. Et on coûtera donc moins cher à la société…»
La relation devient un élément essentiel du moi
Dans ces conditions, qu’est-ce qui pousse les 35-65 ans d’aujourd’hui à s’occuper tout autant, voire plus, des autres générations que par le passé? Au risque d’y user leur santé, et malgré le sentiment de n’avoir plus de temps pour soi?
Pour David Prudente, il s’agit d’abord de «respect». «Je suis reconnaissant de ce que mon père m’a transmis, de ce qu’il a fait pour mes frères et moi. La moindre des choses, c’est de lui rendre la pareille et de ne pas déléguer cela à d’autres.» Le fait de redonner ce qu’on a reçu est, avec celui de renforcer le lien avec l’aîné, ce qui ressort de façon très marquée du ressenti des proches aidants, selon l’étude de Statistique Canada. Mais n’aurait-on pas le droit de satisfaire d’abord ses plaisirs? De ne pas se sentir concerné?
Oui, sourit Elena Pulcini, parce qu’il ne s’agit pas de droits ou de morale: cela va bien au-delà. Pour cette professeure de philosophie à l’Université de Florence, spécialiste de l’individualisme contemporain et de la «théorie du care», il est aujourd’hui possible de dépasser la supposée dichotomie entre la volonté d’épanouissement personnel, d’une part, et le prétendu «altruisme», d’autre part. Et cela, grâce à l’émancipation des femmes, et à l’effritement de la conception moderne d’un individu considéré comme souverain, autonome, maître de soi, et uniquement masculin. «Il s’agit de récupérer ce qu’on a perdu en raison de l’hégémonie de l’homo œconomicus, qui a évacué la dimension de la relation, de la vulnérabilité et de la dépendance du sujet. Ou, plutôt, qui l’a confinée dans le privé, et identifiée aux femmes. Dans les générations précédentes, les femmes n’avaient même pas l’idée de ne pas s’occuper de leurs enfants ou de leurs vieux parents: cela aurait voulu dire renier leur rôle naturel.»
Aujourd’hui, dans la pratique, la division sexuée des tâches est encore forte. En 2014, en Suisse, selon l’Office fédéral de la statistique, 68% des femmes de 40 à 64 ans travaillaient à temps partiel, contre 12,5% des hommes du même âge. Mais, dans les esprits des femmes comme des hommes, ces deux dimensions de l’individu – autonome et dépendant – reprennent désormais leur place. Et si le soin n’est plus «naturellement» donné par une catégorie de personnes, il n’y a plus d’autre choix que de le… choisir. En fondant cette responsabilité, non sur un sens du devoir moral, selon Elena Pulcini, mais sur «la reconnaissance de la valeur de la relation», perçue non comme un sacrifice, mais comme un élément essentiel du Moi.
Génération stéréo
A ce titre, les femmes et hommes sandwichs sont en première ligne de ce changement possible de perspective. Parce que la famille, qu’elle soit nucléaire, élargie, recomposée, monoparentale ou LGBT, est peut-être ce qui nous force le plus clairement à reconnaître que l’on est «inéluctablement lié aux autres, à d’autres vies, à d’autres destins, rappelle Elena Pulcini. On a besoin de l’autre, pas dans le sens privatif du terme, mais parce que tout ce qui est joie, bonheur, souffrance aussi, tout ce qui est vie, a quelque chose à faire avec l’autre.»
Aux mots de la philosophe font écho ceux de David Prudente: «Ce n’est pas spontané de s’occuper d’autrui. On serait enclin à dire: je préférerais faire autre chose. Mais est-ce la société qui me conditionne à suivre mon propre plaisir, ou moi qui n’ose pas vivre quelque chose? Je peux me consacrer à mes loisirs et oublier la vraie nature de l’être humain. Mais une petite fille et un père qui a 81 ans, c’est une richesse: je ne me vois pas pris en étau, mais plutôt comme le maillon d’une chaîne. Je suis entre les prémices et l’automne de la vie, au milieu. C’est presque un privilège, j’ai la vie en stéréo.»
_______
La politique et moi: les jeunes ne s’en fichent pas
Réputée individualiste et égocentrique, la jeune génération s’intéresse pourtant au débat public. Une recherche montre qu’elle a de la peine à s’identifier au système des partis.
«La politique, ça ne nous intéresse pas.» C’est par cet avertissement que beaucoup de nouveaux citoyens de 18 ans ont commencé à répondre aux questions de Maxime Felder. Ce sociologue à la Haute école de travail social de Genève – HETS-GE a conduit 80 entretiens avec des jeunes adultes de Suisse romande, dans le cadre d’un projet de recherche sur la fabrication de la citoyenneté juvénile. Pas concernés, les jeunes? «Cinq minutes plus tard, ils nous expliquaient tous les débats sur la piétonisation de la grand-rue dans leur commune, ou la présidentielle en France, ou l’initiative sur les 6 semaines de vacances…»
L’idée d’un supposé désintérêt des jeunes pour la chose publique est ancienne, rappelle Maxime Felder. En réalité, «les jeunes ne se comportent pas de façon très différente des adultes». A une exception près: le vote. C’est là que le moi entre en ligne de compte. «Beaucoup d’adultes finissent par un compromis: faire confiance à tel parti. Ces jeunes, à qui on demande d’être autonomes, vivent plusieurs transitions en même temps. Ils ont une conscience aiguë, à ce moment de leur vie, qu’ils se définissent en tant qu’individus par leurs choix. Comment un parti ou un politicien va-t-il les représenter, s’ils sont uniques? Devoir dire oui ou non, et l’idée d’adhérer à une idéologie, pose problème.» Le fait qu’ils soient si bien informés, précisément, peut accentuer encore leur difficulté à trancher. «Cela peut favoriser l’abstentionnisme, conclut Maxime Felder, mais c’est faire fausse route que d’associer cela au désintérêt.»
_______
Une version de cet article est parue dans la revue Hémisphères (no 10).