En 1996, dans un texte qui sonne aujourd’hui étrangement prophétique, l’écrivain né à Genève imaginait la mort de Swissair. «J’avais un paquet d’actions nominatives…»
Extrait de «Bleu siècle» de Daniel de Roulet. Le narrateur est un vieillard centenaire qui représente à lui seul la Suisse éternelle:
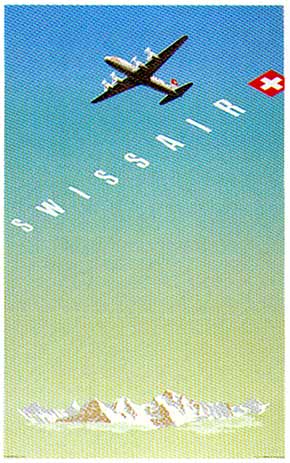
«Ma compagnie d’aviation existe depuis que ma famille l’utilisait pour traverser les mers. Ma-femme-Elisabeth se servait de moins en moins du monomoteur, sauf pour des vols de plaisance, car la réglementation du trafic lui enlevait tout plaisir à piloter. Parfois elle tractait le planeur de mon petit-fils. Je ne l’ai jamais accompagnée.
J’avais un paquet d’actions nominatives qui offrent des vols en première classe dont ma descendance directe profite. Ni le confort des sièges, ni la gastronomie, ni la ponctualité des horaires ne font une compagnie nationale. Une publicité le dit bien. Sur une double page, une jeune hôtesse sourit à sa mère: «Il faut 25 ans pour élever correctement la femme qui vous servira à bord.»
Voilà ce qui plaisait à ma-femme-Elisabeth: être accueillie par son nom en première classe et s’entendre demander en dialecte allemand si elle désirait la Nouvelle Gazette, un drink ou un coussin pour dormir. Elle souriait à l’hôtesse et disait: «Vous, vous êtes de Lucerne.»
Et celle-ci répondait: «Madame vom Pokk, on ne peut rien vous cacher.»

Dans les années 70, j’avais mis des flics à bord pour protéger la compagnie des Palestiniens. Une présence toute symbolique, puisqu’à cette époque la compagnie nationale payait grassement son immunité aux terroristes par une contribution directe dont j’avais organisé la transaction.
A la mort de ma-femme-Elisabeth, j’ai feint de renoncer à des titres de propriété qui ne m’apportaient ni profit ni passe-droits.
La compagnie était le fleuron des nationalistes. A plusieurs reprises, à la table des conseils d’administration, j’avais plaidé la liberté tarifaire, une gestion stricte, une vision planétaire, la fermeture d’une ligne par ci, le déplacement d’un horaire par là. Mais il n’y a pas plus sourds que les rentiers aux bénéfices épanouis.
Quand j’ai senti la situation devenir catastrophique, j’ai cédé un gros paquet d’actions à Bleu Siècle, c’est-à-dire à moi-même, non sans avoir au passage roulé le fisc que je déteste.
Mes compatriotes ont donc appris par la presse que leur compagnie aérienne avait changé de nom, qu’ils ne pouvaient plus être fiers de leur envol. Dans chaque agence de voyage, jusque dans le moindre village, les couleurs nationales ont été amenées et remplacées par la double ligne bleue. Jérémiades, lettres de lecteurs, éditoriaux vertueux, interventions parlementaires, rien ne m’a fait revenir sur une décision que personne ne savait mienne.
En quelques heures, tous les actionnaires avaient cédé à Bleu Siècle et il n’était plus possible de savoir qui le premier avait sacrifié l’intérêt national sur l’autel du profit. Belle démonstration d’égoïsme. Jouant sur les deux tableaux, j’ai observé les simagrées. D’un côté, les discours horrifiés, de l’autre, les négociations par hommes de paille interposés pour obtenir le meilleur prix. Une leçon de civisme à l’envers pour quiconque aurait gardé des illusions sur la morale de ces bourgeois.
A la fin, je me retrouvais avec une flotte d’une quinzaine de gros porteurs et une vingtaine de moyens courriers que j’ai fait gérer par une petite équipe de spécialistes. Ils n’avaient aucune idée de la nationalité de l’actionnaire majoritaire. La Nouvelle Gazette de Zurich gaspillait son encre à dénoncer les complots du capitalisme sauvage en provenance du Pacifique.
J’avais déjà 90 ans quand deux des Sept Nains du Parti hégémonique sont venus me demander audience. J’ai fait dire par Mars que j’étais retiré des affaires depuis trop longtemps pour leur être du moindre secours. Ils insistaient, c’était urgent, privé, grave. J’ai accepté de les recevoir dans mon fumoir en y mettant la condescendance que m’avait apprise mon père. Les laisser attendre debout cinq minutes, ne pas s’excuser, puis les saluer chaleureusement: «Que puis-je faire pour vous?»
Ils avaient besoin que je prête ma propriété au bord du Léman pour une rencontre au sommet entre deux grands de ce monde. Ma villa dans les vignes pour Ronille et Gorbille. Je serais dédommagé, une bonne affaire au demeurant.
«Mon sous-continent est tombé bien bas, chers amis. Envoyer chez moi une partie du gouvernement pour une affaire qui se traite entre concierges! N’avez-vous pas d’autres sujets de conversation?»
«Eh bien… c’est que, a dit le plus malin des deux, en s’essuyant le front comme un ouvrier devant une machine à vapeur… nous voudrions, avant les prochaines élections, racheter notre Compagnie aérienne.»
Je leur ai fait un long sermon d’où ressortait qu’il était bien tard pour se préoccuper de leur image de marque et que les lois du marché étaient au-dessus de celles de notre Seigneur.
«Même si je le voulais, mes chers, je n’ai que peu de pouvoir contre la toute-puissance de Bleu Siècle. J’essaierai d’intervenir pour éviter les licenciements avant les élections. Vous savez que je ne suis jamais monté dans un avion de ma vie. Et elle est longue!»
Ils ont hoché la tête comme des ouvriers dépassés par une nouvelle génération de turbines à vapeur et m’ont proposé de passer un coup de fil à Zurich au gazettier chef pour qu’il rassure les électeurs.
Je les ai congédiés. Mars a fait pour moi ce qu’il fallait. Il comprend le moindre geste du vieillard.»
——
Extrait de la fin du chapitre 12, intitulé
«Ma compagnie d’aviation», dans «Bleu Siècle» (p 178-181), éditions du Seuil, septembre 1996, Daniel de Roulet.
Edition allemande: «Blaues Wunder», Limmatverlag, 1999, «Meine Fluggesellschaft» (Seite 187-190).
© Le Seuil


